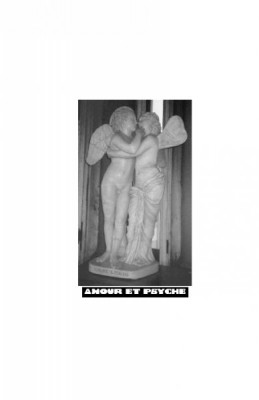Auteur : emmanuellegrun
Date de création : 11-09-2008
Une belle histoire à lire jusqu’au bout ; elle ne manquera certainement pas de vous étonner et de changer votre point de vue des étrangers. Elle est arrivée à un de mes élèves et elle est donc parfaitement authentique. Seuls les noms des personnes concernées ont été changés.
Si mes cours de FLE sont une porte ouverte pour les étrangers de ma région qui veulent ou ont besoin d’apprendre le français, ils sont également, pour certains, une sorte de port d’attache et, parfois aussi, un lieu de rencontres.
L’élève dont je veux vous parler est un Tunisien à l’air jovial. De belle allure et de bonne condition physique, il ne fait pas ses 50 ans. Mais surtout, chez lui, on remarque ses airs étonnés et sa vision un peu candide des réalités, qui en font un perpétuel adolescent à la fois taquin et plein de gentillesse.
Aussi, on est un peu surpris d’apprendre ce que fut sa vie passée en Tunisie. Artisan bijoutier, habitué à voir passer sous ses doigts des diamants, des saphirs, des émeraudes et toutes sortes de perles rares, il avait réussi à se faire une belle situation et avait vécu, avec sa famille, dans des conditions très confortables.
Mais, d’après lui, ce qui fit sa richesse, fit aussi sa ruine. Là-bas, même pour ses proches, il ne fut qu’un coffre-fort. Sans doute avait-on remarqué sa très grande gentillesse et sa facilité à faire confiance ; de toute part, il fut abusé et entraîné dans des coups tordus. Il divorça d’une femme qui essaya, elle aussi, de lui soutirer son argent et eut à faire face à une avalanche de procès. Mais là-bas, la corruption est partout ; impossible d’avoir confiance en la Justice. La seule solution, fut donc aussi la plus extrême : tout abandonner à ces prédateurs qui en voulaient tant à sa fortune, et s’exiler. Ainsi, mon élève – nous l’appellerons Mounir – laissa derrière lui tous ses biens et se retrouva en France, plus démuni et plus seul que jamais.
Mais il réussit à obtenir des papiers et une société d’aides à la personne le prit sous sonaile pour ainsi dire ; ses recruteurs avaient aussitôt repéré chez cet homme d’excellentes qualités manuelles en plus d’un côté sérieux et volontaire. Mais à cela, il restait un obstacle : la langue. Aussi, c’est cette sociéré qui envoya Mounir à mes cours.
Quand Mounir est arrivé, on avait l’impression d’avoir un homme abattu, au bout du rouleau ; en fin de compte, il était en pleine dépression. Mais très vite son comportement se transforma et, indéniablement, mes cours y étaient pour quelque chose.
En effet, grâce aux cours, Mounir put sortir de son isolement et le contact avec les autres élèves lui redonna une autre vigueur et une joie de vivre tout à fait inattendue. Autant dire, la métamorphose fut totale. Ses progrès en français ne furent pas aussi rapides que l’évolution de son moral, néanmoins il tenait bon et s’acharnait avec une certaine constance qui l’aidait à avancer. A ses efforts, on devinait que la montée était dure, mais il avait aussi la patience et la tenacité de la tortue qui arrive, parfois, à doubler le lièvre. Peu à peu, il se mit à comprendre, puis à parler, mais il faut dire qu’il avait là une raison supplémentaire qui le motivait ; celle de communiquer avec les autres élèves qui, bin souvent, n’étaient pas capables de le comprendre dans sa langue.
Ainsi, Mounir apprit bien vite à mettre de l’ambiance dans les cours et, il faut dire les choses, il était assez doué pour ça. Avec ses questions déconcertantes, ses intonations, sa manière de déformer le sens des phrases, parfois involontairement, il réussissait assez facilement à provoquer des fous rire, ce qui le rendit rapidement très sympathique aux yeux des autres élèves et, surtout, je dirais, des jeunes filles. Car bien sûr, pour ce grand cœur esseulé qu’était Mounir, l’idée d’une conquête féminine ne tarda à le tarauder. Mais au lieu de se tourner vers des femmes de sa communauté, comme on aurait pu s’y attendre, c’est à la communauté philippine qu’il s’intéressa.
Dans cette communauté philippine, presque essentiellement des femmes, filles mères pour la plupart, et qui envoient à leurs enfants restés au pays, une partie de leur salaire durement gagné en France, dans des heures de ménage ou de garde d’enfants.
Aux Philippines, on est dans une telle misère noire, que bien des pères refusent de prendre en charge l’éducation de leurs enfants. Alors, soit on est dans une famille traditionnelle où les jeunes filles vierges sont mariées contre leur gré à des maris qu’elles n’ont pas choisi ; soit les jeunes filles sont laissées libres et dans ce cas, la plupart du temps, elles se retrouvent seules à élever leurs enfants.
Mais le désespoir de ces jeunes femmes ne s’arrête pas là ; trop démunies pour pouvoir subenir aux besoins de leurs enfants, toutes courent après des solutions qui leur font éviter une vie de mendicité dans la rue. Certaines essayent le chemin des études, mais là encore, peu d’espoir d’ascension, ni de s’en sortir. Aussi, l’unique porte suscepitble de s’ouvrir sur leurs rêves devient l’étranger. Cependant, quelle porte bien dangereuse quand on connaît les pays susceptibles de recruter ces femmes ; l’un de ces Edolrado n’est autre que l’Arabie Saoudite où, certes, les pétrodollards coulent à flot, mais où – comme chacun sait – les conditions de la femme sont des plus terribles.
Pour ces Philippines, le besoin d’argent est tellement prioritaire qu’elles négligent les risquent qu’elles encourent à se rendre dans des pays comme celui-ci. Pour elles, aucun danger n’est assez grand pour les dissuader d’un changement de vie. Il faut absolument qu’elles tentent le tout pour le tout, non seulement pour elles mais aussi pour leurs enfants, et le sacrifice d’une mère pour son enfant, ça peut même être aussi la mort.
Aussi, beaucoup d’entre elles tombent dans le piège de familles saoudiennes, qui saisissent leurs papiers et en font des esclaves. Les unes sont battues ; les autres violées ; on les empêche de sortir, de dormir, de manger à leur faim. Dans ce pays, on continue encore à lapider les femmes, à couper des mains et à trancher des têtes. D’après une de mes élèves, là-bas, après une exécution publique, les spectateurs applaudissent. Comme au spectacle, ils se sont bie régalés... C’est dire les mentalités.
Comment fuir cet enfer, dans un pays où c’est la barbarie qui fait la loi et la moralité de tout un peuple ? Beaucoup n’y parviendront sans doute jamais. Mais dans les têtes de ces femmes, il y a quand même une toute petite lueur qui brille, juste une petite lueur qui les aide à tenir et à supporter l’insupportable. Chaque matin, à leur réveil, elles ont cette lueur qui les aide à se lever et chaque soir c’est cette même lueur qui les aide à s’endormir. Et quelle est donc cette peitte lumière qui leur donne tant la force d’espérer ? Tout simplement, elles ont entendu parler d’un pays ; dans ce pays, pas autant de luxe et de richesse qu’en Arabie Saoudite, mais il y a quelque chose de bien plus précieux et que l’on appelle les Droits de l’Homme. Ce pays, bien sûr, c’est la France, et c’est ça ce qui permet à ses femmes de tenir dans l’enfer.
Pour une de mes élèves, le miracle eut lieu au cours d’un voyage. La famille saoudienne qui la retenait comme esclave avait décidé de passer ses vacances en France : une véritable aubaine pour mon élève, qui ne loupa pas l’occasion de prendre la poudre d’escampette. C’est donc comme ça qu’elle est arrivée en France ; en fuyant ses tortionnaires.
Pour d’autres, la solution reste celle de passeurs clandestins. C’est très dangereux, très incertain et surtout très cher, mais là encore, cela reste l’unique solution. Et ce qu’ a choisi cette maman philippine que nous appellerons Marica. Marica a pu laisser ses enfants à sa famille en échange de promesses d’argent, qu’elle enverrait de l’étranger. Mais Marica ne peut pas payer. Cependant, il lui reste une maison. Si elle la vend, elle pourra donner un peu d’argent à ses enfants, et tout le reste ira à un passeur. Tout le reste, c’est-à-dire, l’équivalent de 10.000 euros, ce qui là-bas, correspond à l’argent de toute une vie.
Comme Mounir, Marica doit se séparer de tous ses biens à des vautours, et elle va se retrouver en France, seule et sans ressources. Mais l’essentiel est là : elle est France ; elle peut vivre librement et travailler pour ses enfants : elle fait partie des heureuses rescapées de l’enfer. Rapidement, elle va finir par trouver des heures de ménage et se débrouiller pour partager le loyer d’une chambre de bonne avec une amie.
Marica ne parle pas français, mais elle hésite à prendre des cours. Ses expériences passées ont fait d’elle une femme effarouchée. Elle se méfie de tout, y compris des structures administratives. Marica est seulement passée dans l’association, juste pour voir, mais elle n’est pas restée ; son seul refuge, ce sont ses amies philippines et elle ne voit donc pas l’intérêt d’apprendre la langue ; ses amies philippines seront de toute façon sa seule famille.
Marica croit ça, mais en fin de compte, elle va se tromper. Car, quelques années plus tard, celui qu’elle rencontre, c’est Mounir. Mounir et Marica ne parlent pas la même langue ; ils n’ont pas la même culture, ni les mêmes traditions, ni la même religion ; tout les sépare, sauf bien sûr ce desrin de naufragé de la vie qui les ont fait échouer l’un et l’autre en France. Alors, Marica prend une décision ; elle fait sa valise et va s’installer chez Mounir.
On pourrait dire qu’il s’agit là, pour l’un et l’autre, de l’heureux dénouement d’un terrible parcours, qui les mène enfin, à une vie tranquille et tant méritée, où enfin il devient possible de goûter à la saveur du bonheur. Mais leur histoire ne s’arrête pas là...
Après son travail, Marica doit prendre un train dans une gare de Versailles. Arrivent des policiers. Contrôle d’identité. On lui demande ses papiers. Marica n’en a pas. Marica ne prendra pas son train, comme prévu ; elle est emmenée dans un commissariat de l’Essonne.
Quand Mounir apprend la nouvelle, c’est le coup de massu. Marica est sa seule joie de vivre, son seul bonheur. En France, il n’a qu’elle ; sans elle, il va se retrouver une fois encore, seul au monde... Aussi, à l’instant même où Mounir apprend la nouvelle, sa décision est déjà prise : il fera tout, absoluement tout pour essayer de libérer son amie. Et déjà, il commence par manquer son travail pour aller la retrouver dans le commissariat de l’Essonne.
Quand il arrive sur place, il demande aussitôt des nouvelles de Marica et on essaye alors de le rassurer : son amie va bien. Mais Mounir entend pleurer et, pas de doute, c’est bien Marica qui pleure. Comment peut-elle aller bien si elle pleure ? Il demande à la voir. Et là, quelle surprise : Marica n’est pas dans une cellule, non, mais dans une cage d’un mètre sur un mètre, sans eau ni électricité, et infectée par d’insupportables odeurs d’urine et d’excrément. Et c’est dans ce lieu insupportable, où certains hésiteraient à mettre leur chien, que Marica doit rester enfermer 48 heures, sans vêtement de rechange, sans brosse à dents... rien. Pour Mounir, la situation est presque aussi intolérable que pour son amie. Pas question qu’il la laisse, pas question qu’il l’abandonne. D’ailleurs, Marica lui supplie de l’aider.
Marica ne parle pas français, et pour Mounir, s’exprimer dans cette langue reste difficile, mais il peut y arriver. Son seul espoir est là ; il doit appeler “à l’aide” et il faut parler français pour cela. Or, des deux, seul Mounir peut le faire.
Sans attendre, Mounir va retrouver la communauté philippine. Là, il va bientôt pouvoir parler aux amies de Marica et bénéficier d’un précieux soutien. Du moins, c’est ce qu’il croit. Mais quand il arrive, les Philippins sont soudains frappés d’une étrange amnésie. Marica ? Mais c’est qui ? On ne connaît pas cette personne là...
Mounir à compris ; il n’aura personne pour l’aider et pour aider Marica. Dès lors, il n’y a plus que lui pour tenter d’entreprendre quelque chose. Ainsi, tout le destin de Marica, désormais, repose sur ses seules épaules. Car Mounir, bien sûr, veut croire qu’il est possible de la libérer. Ici, c’est le pays des Droits de l’Homme, la Justice n’est pas corrompue comme dans son pays. Ici, on peut encore croire à la Justice.
Quarante-huit heures se sont écoulées. Pas de libérations possibles pour Marica. Celle-ci doit être alors transférée dans le Centre de rétention de Plaisir, où des étrangers du monde entier attendent sans grand espoir, le moment d’être jugé.
Changement total de décor ; cette fois des cellules spacieuses avec des draps propres et les repas qui sont servis, offrent une nourriture de bonne qualité et appétissante. Marica est tellement stupéfaite par ce confort, qu’elle en oublie presque les raisons de sa détention : elle a presque l’impression d’être à l’hôtel.
Mais pour Mounir, le moral est au plus bas. Il finit par comprendre : l’espoir de libérer Marica est faible. Même s’il a décidé de poursuivre son combat, il ne sait plus très bien ce qu’il doit croire. Peut-être qu’il a déjà perdiu son amie ; peut-être qu’il devrait déjà commencer à l’oublier.
Mais tant qu’elle sera là, il ne la laissera pas. Tant qu’il restera des solutions, il les emploiera, les unes après les autres, jusqu’à les épuiser toutes. On pourrait se dire que Mounir est très naïf, mais pour lui, il avant tout un grand sentimental. Et là, c’est simplement son cœur qu’il veut écouter.
Tous les jours, il va à Plaisir pour retrouver son amie. Drôle de nom que celui de cette ville, alors que c’est dans cette ville-même que deux destins se retrouvent séparés.
Mounir entre en contact avec l’avocat commis d’office. Il espère obtenir de lui des solutions, des conseils, ou du moins quelques propos réconfortants qui laisseraient entendre qu’il existe encore un moyen de faire fléchir le juge. Mais l’avocat n’hésite pas à afficher son pessimisme. Il ne voit pas ce qu’il peut plaider ; Marica est le type même d’étranger qui ne pose aucun problème aux conditions d’expulsion.
L’avocat commis d’office ne veut pas l’aider, qu’importe. Mounir en trouvera un autre qui acceptera de le faire, et il payera ce qu’il faut payer.
Chacun a essayé de le résonner : à quoi cela servait-il de se ruiner pour un cas de aussi désespéré que le sien ? Mounir, ne voulait-il pas admettre qu’il s’agissait là d’une lutte du pot de terre contre le peau de fer ? Mais Mounir était persuadé que l’on pouvait encore croire à la Justice française, ce pays des Droits de l’Homme.
Aussi, peu après, le voilà dans le cabinet d’une grande avocate de Versailles. L’avocate comprend vite que l’homme s’est laissé surtout égaré par son désespoir. Elle ne tient pas à abuser de sa naïveté et lui expose clairement la situation.
Même avec le meilleur des dossiers, son amie risque à 80% d’être expulsée dans son pays, et le prix des honoraires s’élève presque à 2000 €. Tout au plus, elle peut proposer une solution intermédiaire : pour 700 €, elle peut rencontrer son amie au parloir et essayer de trouver des solutions avec elle.
Sept cent euros juste pour une petite visite au parloir ! Mounir comprend bien vite que ça ne vaut pas le coup. Alors, il salue l’avocate, et la laisse après l’avoir également remerciée pour sa franchise.
Mais retenez bien le chiffre avancé par l’avocate : 80% d’échec avait-elle prédit.
Dépité, Mounir retourne vers la communauté philippine. Mais là, tout à coup, il a une surprise. Une amie de Marica veut lui parler. Elle a peut-être l’idée d’une solution. Inutile de passer par les associations qui sont submergées de dossier. En revanche, au Consulat, il y a un homme qui peut peut-être les aider.
Sans hésiter, Mounir décide de rencontrer l’homme en question. Celui-ci ne peut rien faire par lui-même, mais il connaît l’adresse d’un très bon avocat qui pourra l’aider. Mounir, malgré son côté naïf, a compris ; l’homme et l’avocat sont de mèche et tous deux tirent profit de ce marché juteux qu’offre le désespoir des hommes. Car il est évident que le désespoir est encore le meilleur des arguments pour inciter un homme à débourser.
Mais de toute façon, Mounir n’a pas le choix : il doit rencontrer cet avocat, puisque dès lors, ses dernières chances de revoir Marica sont entre les mains de cet homme.
L’avocat étudie la situation avec une certaine circonspection ; on voit qu’il est déjà rôdé aux affaires de ce genre. Et en quelques minutes, il réussit à afficher son pronostic : à 80% il a la possibilité de libérer son amie.
Mounir n’est pas sûr d’avoir bien compris ; l’avocat parle-t-il de 80% de risque d’échec, comme sa consœur de Versailles, ou au contraire de 80% d’espoir de réussir, ce qui paraît impossible ?
Mais Maître X... insiste bien : 80% de réussite, en raison d’un vice de procédure. D’ailleurs, les conditions de versement d’honoraires qu’il propose ne peuvent que rassurer son client. En cas d’échec, Mounir ne devra payer que 750 €, mais s’il réussit, il lui faudra verser 500 € supplémentaires qui serviront aux démarches nécessaires pour l’obtention des papiers, soit un total de 1250 € comme prix de la liberté.
Pour Mounir, ce sont des sommes importantes qui vont l’obliger à s’endetter, mais qu’importe... Qu’on ne lui parle pas de la valeur de l’argent. Lui, il a su ce que c’était la valeur de l’argent et il a vu vers quoi l’argent l’a mené. Il n’a donc aucune leçon à recevoir de quiconque ; qu’importe s’il s’endette : de toute façon, il préfère s’endetter par amour plutôt que de s’enrichir pour combler un vide affectif. Et pour avoir connu les deux situations, il sait de quoi il parle, Mounir !
Arrive le jour du jugement. Ce jour-là, sur le bureau du juge, 80 dossiers qui portent avec eux, le destin de 80 étrangers et parmi ces étrangers, il y a Marica.
Oui, une fois encore, on se retrouve avec ce nombre 80. Celui qui rappelle les statistiques des avocats : 80% d’échec pour l’un ; 80% de réussite pour l’autre. La contradiction totale.
Parmi ces étrangers, pas de Philippins, mais des destinations aussi lointaines que celle de Marica, car dès lors, on pense déjà au trajet, à la destination, au retour au pays. Et parmi ces retours attendus, il y en a aussi des quantités du côté de l’Asie : des Indous, des Malaisiens, des Japonais... Les lois des sans papiers semblent vraiment n’épargner aucune nation.
Les verdicts se suivent et se ressemblent. Pour tous, le juge prononce la décision de l’expulsion. Tour à tour, des rêves qui se brisent dans ce Tribunal devenu pour la circonstance, un abattoir de destinées humaines. Mais Marica n’est pas encore passée, et quand Marica arrive à son tour à la barre, elle est accompagnée d’un très bon avocat. Décision du juge : Marica ne sera pas expulsée.
Dans ce Tribunal, 80 étrangers ont été jugés et tous ont été expulsés à l’exception de Marica. Cette fois, les chiffres parlent d’eux-mêmes. En fin de compte, pour Marica, la chance de s’en sortir était de 1 sur 80, mais cette chance elle l’avait déjà rencontrée en rencontrant Mounir.
Quand Mounir est allée la chercher à la sortie de sa prison, celle-ci lui a dit ironiquement :
– “ Ici, on était bien logé, bien nourri, c’était comme des vacances à l’hôtel.”
Alors, Mounir lui a répondu avec la même ironie :
– Ecoute, si l’endroit te plaît autant, tu peux toujours y rester.”
Voilà donc une histoire d’amour tout à fait authentique, et comme il en existe rarement à notre époque moderne. C’est une histoire toute récente, qui s’est déroulée durant ces dernières vacances de Pâques et je tenais à vous la racontrer pour vous montrer que l’on ne voit plus vraiment les étrangers de la même façon, quand on prend la peine de s’intéresser à leur vie. Du moins, j’espère que ce témoignage pourra permettre à des gens racistes de se débarrasser de leur haine. Car, j’ai envie d’ajouter : 80% de haine raciale est due à de l’ignorance. Oui, j’ai bien dit 80% !...
Après les vacances de Pâques, Mounir était de nouveau présent aux cours de français et tout est redevenu normal.
Sauf que maintenant, ce sont les autres élèves qui taquinent Mounir. Et voilà ce qu’il entend comme commentaire :
– « Tu as libéré ta belle de sa prison. Maintenant tu n’as pas le choix : tu dois l’épouser.»